 |
|
|
FÉMINISTES ANTINUCLÉAIRES
|
|
| |
HISTOIRES DE LUTTES
Antinucléaire féministe
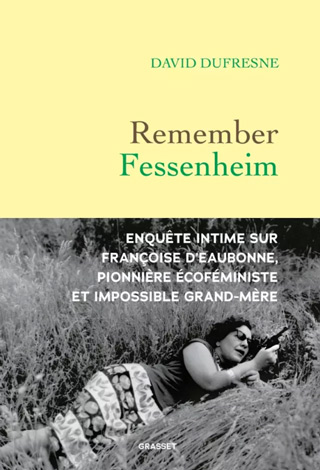
|
Remember Fessenheim
Vingt ans après la mort de Françoise d'Eaubonne à l’été 2005, David Dufresne (animateur du média Au Poste ! – et auteur de la postface de Nos Amis les experts) enquête à sa façon sur son impossible grand-mère. Dans son livre qui emprunte son titre à une réplique 'un film de Clint Eastwood (Grasset, 2025), il nous offre le portrait d’une activiste radicale, drôle, en lutte partout, dans les rues et avec sa machine à écrire.
Françoise d’Eaubonne fut de tous les grands combats d’après- guerre : contre la guerre en Algérie ; sur les barricades de 68 ; pour l’égalité et le droit à l’avortement ; militante du MLF et fondatrice du Front homosexuel d’action révolutionnaire. Éco-anxieuse avant tout le monde, elle forgea le concept d’écoféminisme : « un nouvel humanisme né avec la fin irréversible de la société mâle ». Avec un ami, elle pose une bombe sur le chantier de la centrale nucléaire de Fessenheim, événement historique jamais résolu. La liberté chevillée au corps, elle apparaît ici comme la plus libre des femmes libres.
En savoir plus
|
« Françoise d'Eaubonne, sa sorcière bien-aimée »,
avec David Dufresne, France Culture, le 20 septembre 2025
Pour la première fois, le journaliste David Dufresne évoque publiquement sa grand-mère, l'écoféministe Françoise d'Eaubonne. À l'issue d'une minutieuse enquête, il dresse le portrait de cette femme hors-norme au prisme d'un évènement clé : l'attentat du 3 mai 1975 contre la centrale de Fessenheim.
 « Françoise d’Eaubonne,
pionnière de l’écoféminisme et adepte du
sabotage », Reporterre, oct.
2019 « Françoise d’Eaubonne,
pionnière de l’écoféminisme et adepte du
sabotage », Reporterre, oct.
2019

Dans
le cadre de son exposition «
L’Âge atomique - les artistes à
l’épreuve de l’histoire », le Musée d'Art moderne de Paris a
proposé quatre rencontre-discussions entre
chercheuses, anthropologues, artistes,
historienne des sciences, en leur proposant
d’évoquer ensemble l’ère nucléaire dans le
domaine des arts, des sciences et de la
politique du début du XXème siècle à nos
jours.
|
première rencontre du
cycle :
Écoféminismes
antinucléaires
 le
7 novembre 2024, avec Élodie Royer le
7 novembre 2024, avec Élodie Royer
 et
Kyveli Mavrokordopoulou et
Kyveli Mavrokordopoulou
À
l'intersection des mouvements
féministes, écologiques et pacifistes,
l'écoféminisme apparait simultanément
en Europe, aux États-Unis, en
Australie et dans différentes nations
du Pacifique, dans la seconde moitié
des années 1970. Dès le début, ces
collectivités et penseuses féministes
s’engagent contre les technologies
nucléaires en ne faisant plus la
différence entre le domaine civil – le
réacteur – et le domaine militaire –
la bombe.
Ces
collectifs entretiennent souvent des
liens transnationaux entre eux et sont
parmi les premiers à allier la pensée
anticoloniale à la lutte
antinucléaire. Ils révèlent que la
domination patriarcale est exercée à
la fois sur les femmes et sur la
nature.
|
|

Women’s Pentagon Action, novembre 1980
© Diana Mara Henry |
De nouvelles formes de militantisme
s’inventent, à la lisière de l’art et de
l’activisme, privilégiant des formats
flexibles et transportables, allant de
l’émission de radio à la performance, à des
tournées antinucléaires mais aussi à
l’occupation de camps militaires accompagnée
par des actions festives.
À l’aune de
la triple catastrophe de Fukushima, plusieurs
pratiques artistiques ancrées dans des lieux
marqués par des bouleversements
environnementaux au Japon seront aussi
convoquées dans une perspective écoféministe.
Par cette mise en regard d'œuvres et de
luttes, il s’agira de tisser des liens
esthétiques et biographiques entre des
pratiques, des corps et des territoires.

Une présentation plus complète des
trois autres conférences se trouve sur le site du MAM
:
- La Hague,
paysage nucléaire avec Agnès Villette et
Laura Molton, le 12 décembre 2024
- L’histoire de la représentation de l'atome
avec Charlotte Bigg et Gabrielle Decamous, 16
jan. 2025
- Fukushima
Reprises. Lecture-performance de Sophie
Houdart et Mélanie Pavy, le 6 février 2025

Sorcières,
vénères... et antinucléaires !
|

Les « Bombes atomiques
» à Bure - photo © Roxanne
Gauthier/Reporterre
|
|
Longtemps
occultée, une tradition de lutte féministe
contre le nucléaire ressurgit peu à peu. À
Bure, le collectif des Bombes
Atomiques organisait du 20 au 22
septembre 2019 un weekend antinucléaire
sans homme cisgenre. Une participante
exhume aujourd'hui son journal de bord de
l'époque. L’objectif féminisme
anti-nucléaire est de montrer que les
systèmes de domination – patriarcat et
capitalisme, principalement – sont
imbriqués et ne peuvent être détruits
qu’ensemble. « Le nucléaire est
un monstre du patriarcat »
aurait pu dire l’un·e de nous.
Lire
ce texte
|
|
|
Des
femmes contre des Missiles
Rêves,
idées et actions à Greenham Common
par Alice COOK &
Gwyn KIRK,
Éditions
Cambourakis, 2016
En 1981, sur fond de
Guerre froide, des femmes organisent,
autour de la base militaire de
Greenham Common en Angleterre, un camp
pacifiste pour protester contre la
décision de l’OTAN de stocker des
missiles nucléaires sur ce site. Par
une série d’actions non-violentes
directes à Greenham Common et à
travers l’Angleterre tout entière, des
femmes ont ainsi exprimé leur
opposition à la guerre, au
militarisme, à la violence, prenant le
parti de la justice, de la paix, de la
créativité, des échanges et de la
joie.
|
|
 |
|

|
|
Retour à La
Hague
par Xavière
GAUTHIER, Sophie HOUDART
& Isabelle CAMBOURAKIS, Cambourakis,
2022
À l’heure où la
France, ses dirigeants, ses lobbys
nucléaires sont en pleine opération de
réhabilitation de l’atome et
projettent de couvrir le territoire de
nouvelles centrales comme ce fut le
cas dans les années 1970, la réédition
de « La Hague, ma terre violentée
» montre qu’il était possible
au tournant des années 1980
d’articuler discours féministe et
antinucléaire. Un avant-propos en forme de
correspondance à trois voix propose
une réflexion sur ce que signifie
vivre en territoire nucléarisé, tisse
des liens entre La Hague et le Japon
et débat de l’invisibilité de la
question nucléaire.
 Article sur le livre
et entretien, Maze,
mai 2022 Article sur le livre
et entretien, Maze,
mai 2022
|
Voir à ce propos : « Regards croisés sur les
luttes féministes antinucléaires des années
1970 »
de Coline GUÉRIN et Lisa PARIS, Terrestres,
le 1° décembre 2022
Et écouter : « Retour à La Hague »,
une expérience de Bastien LAMBERT, France
Culture, octobre 2022
Pour aller plus loin
:
 « If you love this planet. Des
femmes contre le nucléaire », Panthère
Première n° 5, printemps-été 2020 « If you love this planet. Des
femmes contre le nucléaire », Panthère
Première n° 5, printemps-été 2020
 « L’énergie nucléaire dans le
discours féministe », par Dorothy NELKIN,
Sociologie et sociétés, 1981 « L’énergie nucléaire dans le
discours féministe », par Dorothy NELKIN,
Sociologie et sociétés, 1981
|

 |
En mémoire de
Esther Peter-Davis, décédée le 8 octobre
2022
Esther Peter-Davis,
celle qui a toujours dit non au
nucléaire
par Isabelle Mayault,
Sept Infos n° 17, mai-juin 2017
Esther
Peter-Davis est la première militante
antinucléaire française. C'est à Genève,
dans les cercles pacifistes où se
construisait l'Europe à la sortie de la
guerre, mais aussi dans l'Afrique en
voie de décolonisation qu'elle a trouvé
sa vocation. Avant de rentrer en Alsace,
sa région natale, et de se battre pied à
pied contre l'ouverture de la centrale
de Fessenheim. (...)
Télécharger
ce texte
|
 |
|
|
|
Pourquoi les peuples
laissent-ils s’accomplir le crime nucléaire
contre les prochaines générations ?
par Nicole ROELENS, FSM
antinucléaire, Paris, le 3 novembre 2017
Une dimension encore peu
appréhendée du crime nucléaire : son impact
sanitaire est d’autant plus violent que l’on
remonte le cours de la vie vers son origine.
Le nucléaire est d’abord une
technique de destruction massive, l’atout majeur
de la thanatocratie c’est-à-dire l’attribution
du pouvoir à ceux qui détiennent la plus grande
capacité d’extermination.

Le missile nucléaire
russe RS-28 Sarmat, dit « Satan » |
|
L’impuissance des femmes qui
donnent la vie face à la destruction
technologique de la descendance
s’accompagne d’une inertie de la très
grande majorité des hommes devant la
prolifération d’un technomonde hostile au
vivant. Ce technomonde les fascine parce
qu’il est synonyme de toute puissance et
que les hommes n’ont majoritairement pas
renoncé aux illusions de toute-puissance.
Il est temps de dire que l’inertie
face au processus d’autodestruction de
l’humanité tient à la complicité de la
société sexiste avec la guerre larvée
contre les femmes et les humains de
demain.
Cette guerre est menée en
toute inconscience par les mâles les plus
hégémoniques. Elle est impensée, mais elle
est attestée par l’indifférence collective
à l’égard des intérêts
intergénérationnels, par la dégradation
contemporaine du processus d’engendrement,
par la destruction systématique des
conditions de survie de nos descendants.
|
L’agressivité des humains envers
leurs successeurs est proportionnelle à leur
insondable désarroi devant leur condition
d’êtres vivants mortels interdépendants et
sexués. Cela explique un grand nombre de
maltraitances envers les enfants mais cela va
bien au-delà car il est question de la
sauvegarde des illusions égocentriques
individuelles et collectives.
|
 |
|
Mémorial pour la Paix à Hiroshima : statue
offerte en 1959 par le sulpteur Hongô Shin
au Maire d'Hiroshima, M. Hamai, à l'occasion du 5°
congrès mondial pour l'abolition des armes
nucléaires,
inaugurée en 1960 grâce au soutien de
l'association des femmes de Hiroshima
|
|
